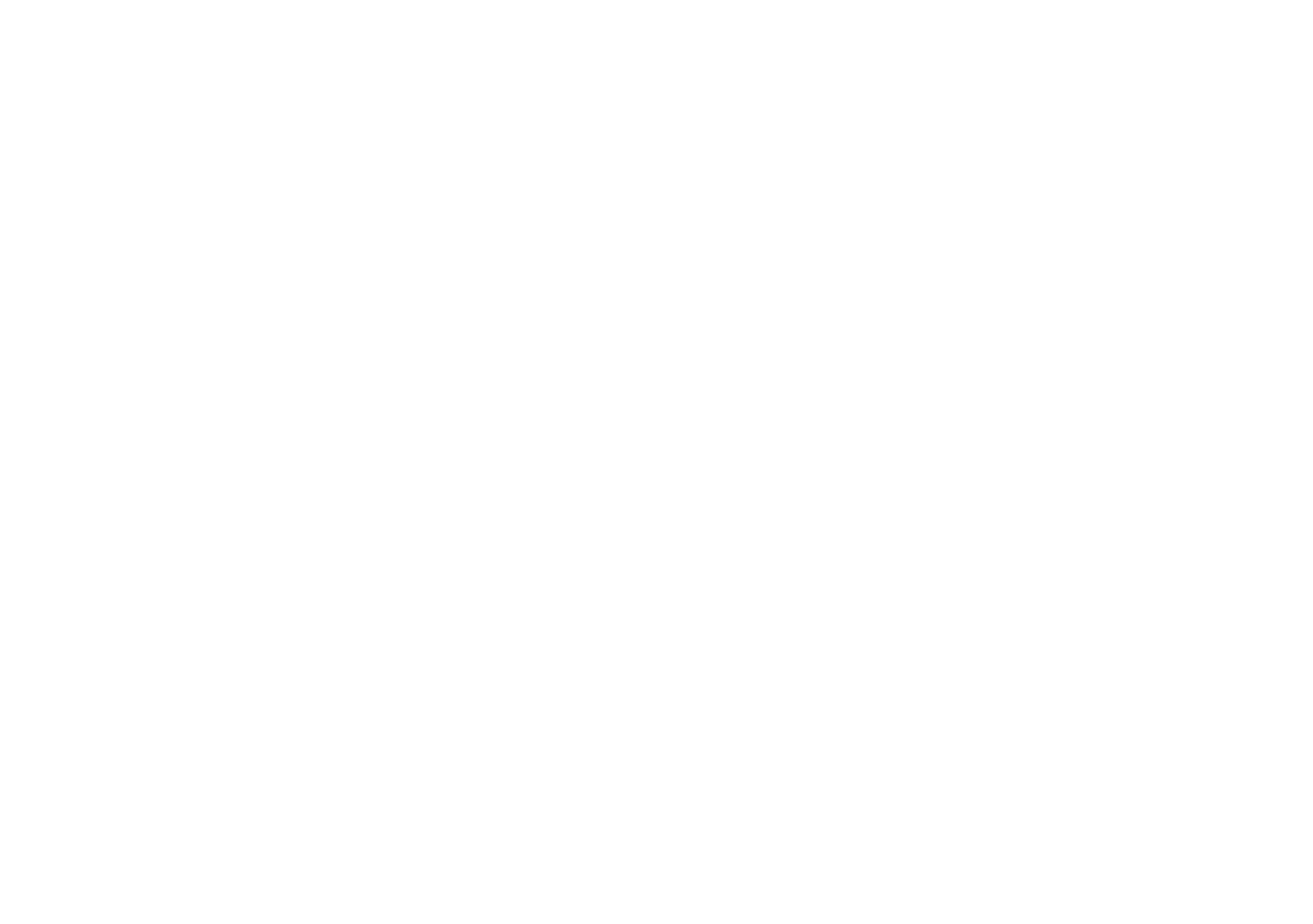Petite histoire de notre Société
Le récit fait ici est le regroupement de textes parut dans divers Pays Lorrain. Pour ne pas alourdir ces récit, nous nous sommes dispensés des (...) lors des coupes, mais le puriste pourra consulter les originaux sur Gallica. Les textes sont les transcriptions intégrales des articles et les idées exprimées n'engagent que leurs auteurs.
Pierre Marot - Le Pays Lorrain 1936 A28 Vol5
Les prémices jusqu'à la création
L'histoire du Musée lorrain est, si l'on veut, réconfortante. On lui donnerait volontiers comme sous-titre : comment le bon sens finit par triompher de l'ignorance ; mais elle est aussi attristante, car, pour vaincre la routine, la passivité, la sottise, on a dû faire preuve d'une obstination peu commune. Pourquoi faut-il que tant d'efforts aient été dépensés pour briser des résistances si foncièrement absurdes ? Pourquoi faut-il que des conceptions si clairement utiles n'aient point toujours été encouragées, soutenues ? Pourquoi, cédant aux convenances du moment, a-t-on usé parfois de tant d'atermoiements pour différer ce qui s'imposait? Pouvons-nous espérer que ce bref historique révélant les fautes du passé contribuera à éviter le retour de certaines erreurs au cas fort improbable où l'on serait tenté de les commettre? Il a été écrit tout simplement ad narrandum. Ce n'est pas notre faute si naturellement les faits s'enchaînent ad probandum. Nous l'avons dit, l'histoire est parfois une leçon.
La dispersion des ordres religieux, la suppression de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Nancy, fondée par Stanislas, le vandalisme enfin, tout s'était réuni pour détourner les esprits de l'étude des temps révolus.
L'érudit Mory d'Elvange avait péri sur l'échafaud en 1794, arraché aux dernières recherches qu'il consacrait à l'histoire de la maison ducale ou aux derniers vestiges d'un passé qui semblait mort à jamais. Jean-Jacques Lionnois, le zélé historien de Nancy, s'éteignait, dans l'indigence, le 14 juin 1806. Les monuments historiques de l'ancienne capitale du duché qu'il avait décrits avec soin disparaissaient sous la pioche des vandales.
Les clochers innombrables qui hérissaient la silhouette de Nancy, tels que les charmants tableaux de Claudot nous en ont laissé le souvenir, tombaient les uns après les autres. Toutes les églises que le graveur Herpin fixait encore en 1791 de sa pointe élégante s'évanouissaient avec leurs tombeaux. Rien n'est plus lamentable que le laconique récit de la démolition de l'église des Minimes que nous a laissé Michel-Hubert Oudinot, l'éditeur de l'oeuvre de Lionnois : tous les monuments funéraires furent réduits en morceaux et les matériaux envoyés aux décombres! La rage des jacobins s'est acharnée sur l'église des Cordeliers, sur sa « chapelle ronde », tombeau des ducs de Lorraine. Les cercueils des princes ont été violés, leurs restes ont été jetés pêle-mêle dans la fosse commune du cimetière de Boudonville. Le sanctuaire des frères de saint François est devenu successivement une auberge, un entrepôt de marchand de charbons, une ambulance. On proposa même de faire passer une rue dans l'axe de sa nef! La pimpante église de Bon-Secours a failli périr, les sépultures de Stanislas et de Catherine Opalinska ont été profanées. Les bataillons de fédérés, de passage à Nancy en 1792, ont détruit dans une rage aveugle maintes oeuvres d'art et mutilé des monuments.
Néanmoins, on songe à sauver quelques souvenirs du passé. A l'hôtel de la Monnaie, un archiviste, ancien huissier de la Chambre des Comptes, François Eloy réussit à conserver à peu près intact le Trésor des chartes de Lorraine. On annexe à l'Ecole centrale un Museum, qui, installé dans la chapelle de la Visitation, reçoit les tableaux confisqués par la Nation, ceux du moins que les fédérés avaient respectés, et quelques œuvres d'art, trop rares, dont l'intérêt avait été reconnu.
Ce Museum sera le noyau du futur Musée municipal de peinture et de sculpture.
Après le Concordat, on restaure hâtivement l'église de Bon-Secours. L'église des Cordeliers devient une annexe de Saint-Epvre. Sous la pression de la maison d'Autriche, on commence en 1817 le rétablissement de la chapelle ronde, déjà souhaité en 1810 par le marguillier des paroisses, M. de Montureux-Ficquelmont, dans le compliment qu'il prononça à l'adresse de Marie-Louise, tandis qu'elle traversait Nancy pour rejoindre « son auguste époux ». On apporte sous les voûtes de l'église, qui devient ainsi une sorte de musée lapidaire, les tombeaux des membres de la famille de Lorraine, dispersés dans la province. L'administration encourage toutes les recherches historiques ou archéologiques sur les sépultures des princes lorrains, qui font l'objet d'une vaste enquête. En 1826, les cendres des descendants de Gérard d'Alsace que l'on a pu retrouver sont descendues dans le caveau ducal au cours d'une cérémonie où communient d'un même patriotisme tous les Lorrains fidèles. La Lorraine est cimentée à la France, mais elle elle ne renie pas son passé En 1831, on inaugure sur la place Royale la statue du roi Stanislas, érigée par souscription ouverte dans les départements lorrains; en 1840 des patriotes lorrains célèbrent le duc Léopold en plaçant dans la nef de l'église des Cordeliers un monument commémorant sa mémoire.
Une renaissance de la curiosité historique se précise. Ce sentiment trouvait un stimulant dans la mode. Le théâtre, le roman s'étaient emparés de l'histoire. Le Nancéien Guilbert de Pixerécourt, devenu à Paris le Corneille des boulevards, ne dédaigne point de mettre sur la scène un des grands événements de l'histoire de son pays, la bataille de Nancy. Les imitateurs de Walter Scott ont toutes les faveurs et les journaux, tel le Littérateur lorrain, fourmillent de nouvelles historiques.
Le grand public prend goût au passé à mesure que le romantisme progresse : nos auteurs le leur présentent à leur façon sans doute, ce qui chagrine fort les érudits qui se consacrent à la recherche des documents : l'un d'eux, Noël, qui, pour dire le vrai, n'était point, lui-même, sans reproche, s'emporte contre les fantaisies de « l'histoire romancée ». Les érudits devenaient, en effet, plus nombreux. L'Académie de Nancy s'était reconstituée en 1802; elle avait retrouvé certains de ses anciens membres épris du passé, Jean-François Coster, Jean-Baptiste Lamoureux, auxquels vinrent se joindre des curieux, voire des savants, comme le comte de Villeneuve- Trans; elle entendit, publia même leurs communications historiques.
Le gouvernement, cédant aux instances de l'Académie des Inscriptions, devait d'ailleurs encourager les recherches archéologiques. C'est sous son impulsion que, par arrêté du 3 septembre r89, le préfet constitue dans le département de la Meurthe une Commission d'antiquités. Ce Comité, souvent présidé par les préfets qui, comme le marquis de Villeneuve ou le comte d'Allonville, participent parfois effectivement à ses travaux, répond aux instructions du ministère de l'Instruction publique. Les Haldat, Lamoureux et autres archéologues, les architectes Grillot et Chatelain se mettent à la recherche des antiquités : les ruines de Scarponne, les trouvailles de Norroy, le tombeau de Philippe de Gueldres retiennent longuement leur attention.
La commission réunit des sculptures antiques, des inscriptions et un embryon de Musée se constitue dans un réduit de la Bibliothèque publique, sous l'escalier de l'Hôtel de Ville et la galerie intérieure du palais du Gouvernement.
La commission des antiquités ne poursuivit pas longtemps ses recherches : elle fut dissoute le 1er septembre 1824 et ses archives réunies à celles de l'Académie.
Un arrêté du 29 décembre 1829 la reconstitua. L'ardeur de la renaissance fut brève; à partir de 1830, son zèle déclina, quoique certains de ses membres, comme Soyer-Willemet, Guerrier de Dumast, Monnier, Guibal, Beaupré eussent un goût très vif pour l'archéologie et l'histoire.
D'ailleurs, l'Académie qui comptait parmi ses membres ou ses associés correspondants presque tous ces curieux, faisait la part de plus en plus large du passé.
Augustin Digot, le futur historien de la Lorraine, y donne alors des biographies soignées de Lorrains illustres, qui préludent à ses grands travaux.
Au reste, l'étude de l'histoire et des monuments s'échappait des cénacles. Cayon, par exemple, en marge de l'Académie, publie des ouvrages médiocres sans doute, mais très lus sur la Lorraine, Nancy, Saint-Nicolas-de-Port, les vieilles chroniques, que le public va acheter chez son père, libraire avaricieux. Le préfet de la Meurthe, Arnaud, patronne la Statistique de son département, que Henri Lepage compile avec zèle, en dénombrant les curiosités de la région et en contant l'histoire des communes puisée aux documents d'archives. L'oeuvre de Lepage lui vaut d'être nommé archiviste de la Meurthe : en 1846 il inaugure une carrière qui sera des mieux remplies.
Cette renaissance de l'érudition s'étend à toute la Lorraine : Metz avec son académie, l'Austrasie et une phalange d'érudits : Bégin, Huguenin, Saulcy; Épinal dont la commission d'antiquités, continuée en 1825 par la Société d'Émulation des Vosges, fait des fouilles fructueuses; Bar-le-Duc où Servais commence, dans les greniers poudreux de la Préfecture, à explorer les riches archives de l'ancienne Chambre des Comptes du duché de Bar.
Si tous ces « érudits » ne travaillaient pas avec une méthode également recommandable, du moins faisaient-ils preuve du même cœur, du même acharnement pour découvrir le passé ou conserver ses restes. Appartenant à la bourgeoisie de la province, « rentiers », médecins, magistrats, avocats, fonctionnaires, architectes, professeurs, bibliothécaires ou archivistes, ils étaient l'expression de cette société cultivée à la mode du XVIIIe siècle, doctrinaire, férue de ses devoirs, obstinée, étriquée parfois, attachée au sol avant tout, qui donnait le ton à nos villes et en constituait l'armature.
De solides humanités fortifiées par un droit sens avaient permis à plusieurs d'entre eux d'acquérir les connaissances nécessaires pour déchiffrer les documents, conduire ou exploiter des fouilles avec fruit. D'aucuns étaient ce que l'on appelle communément des originaux, des savants en us, dont la redingote bizarrement coupée et le haut de forme genre tromblon amusaient leurs contemporains. Ils retrouvèrent, souvent par leurs propres moyens, la méthode des bénédictins, des Dom Calmet et de leurs disciples. Peut-être profitèrent-ils des travaux de la nouvelle école d'érudits qui commençait à s'affirmer. Les oeuvres d'Augustin Thierry eurent une profonde influence en province, et on peut la déceler à Nancy. Les instructions du Comité des travaux historiques que Guizot venait de créer, la Société de l'histoire de France, la Société française pour la conservation des monuments historiques d'Arcisse de Caumont et ses fameux congrès scientifiques contribuèrent à ce renouveau.
C'est dans ce milieu que germa sous la Restauration, et s'affirma sous le gouvernement de Juillet, l'idée de la création du Musée historique lorrain dans le palais des ducs de Lorraine.
Pierre Marot - Le Pays Lorrain 1936 A28 Vol5