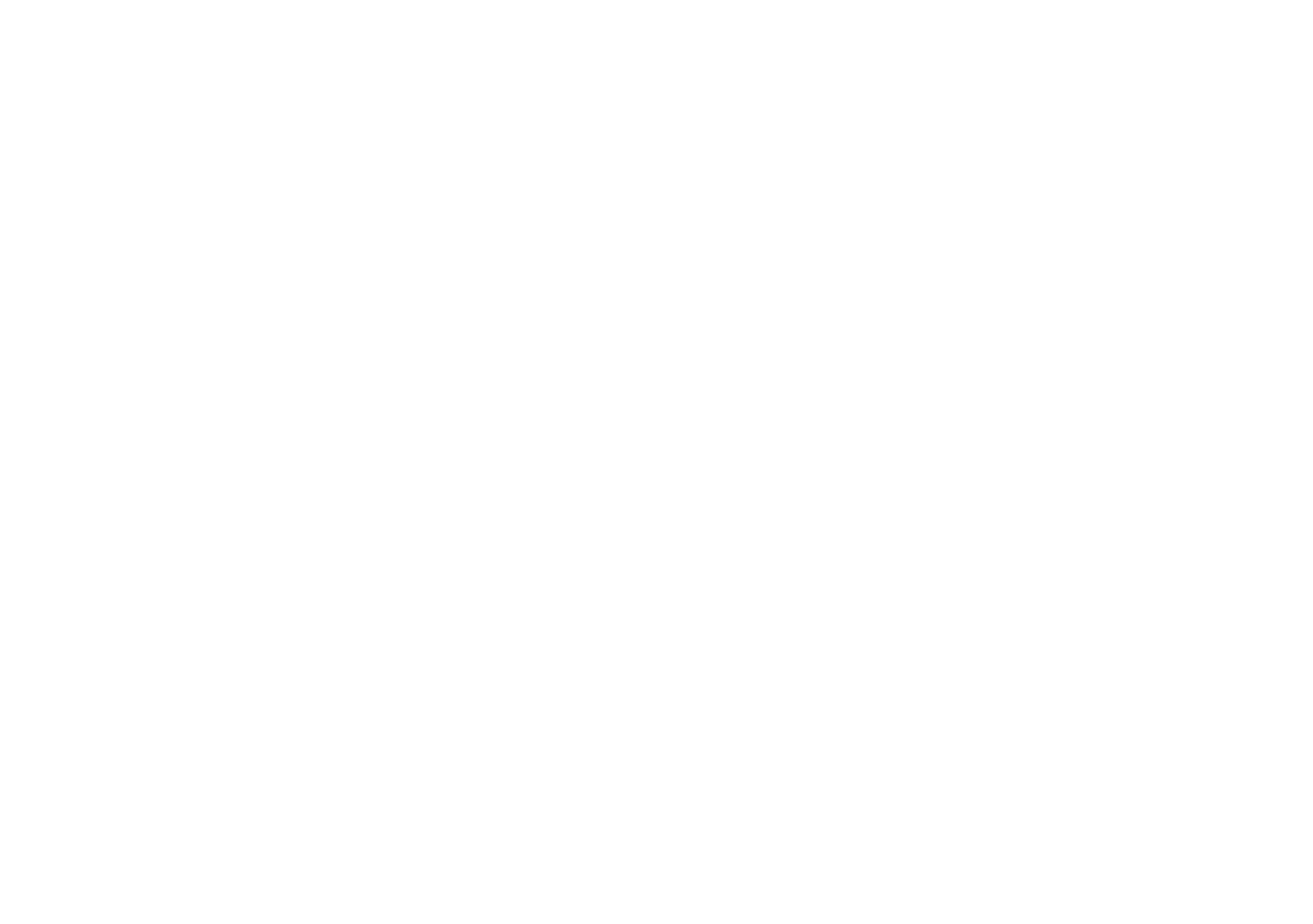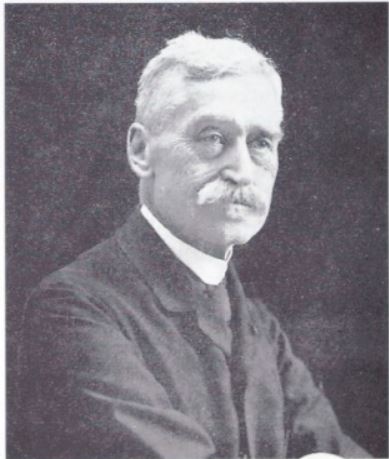Charles GUYOT
Un grand Lorrain 1845-1930
Ses racines, sa vie familiale
Jules Guyot, avoué-notaire à Mirecourt, mourut subitement à l'âge de 45 ans, alors que son fils unique Marie-Charles avait à peine dix ans. Sa veuve, née Laure d'Espinal, se consacra à l'éducation du jeune Charles. Après de solides études classiques (grec, latin), à vingt ans, en 1865, Charles Guyot entra à l'Ecole forestière. Il est possible d'imaginer les raisons qui ont déterminé la vocation de Charles Guyot. Ses aïeux sont fixés depuis longtemps dans le bailliage de Mirecourt, dans cette belle campagne lorraine, vallonnée, du Xaintois. Les paysages sont équilibrés, harmonieux, tranquilles, faits de champs, de prés, de villages groupés autour de l'église, de ruisseaux bordés de saules, de bois aux arbres divers. Aussi, Charles Guyot a-t-il éprouvé très tôt un profond attachement pour son pays. Il l'a exprimé maintes fois dans plusieurs écrits sur Mirecourt et ses habitants, sur les villages du Xaintois, sur la désertion lorraine ou sur l'avenir de la Lorraine. Nul doute que cet environnement de nature, sans oublier le jardin de la maison familiale de Mirecourt qui, de la rue Germiny, descendait jusqu'au Ma- don, n'ait contribué à éveiller la sensibilité du jeune garçon, à ouvrir sa curiosité vis-à-vis de ce qui fait une partie du charme de nos campagnes les arbres et les forêts.
Charles Guyot sort de l'Ecole forestière second en 1867, il est nommé garde général stagiaire à Mirecourt et peu après garde général à Dompaire. Il épouse le 2 septembre 1872 Louise Delpierre, dont la famille habitait à Mirecourt la maison voisine de celle des Guyot. Comme eux. les Delpierre sont de vieille souche lorraine. L'arrière-grand-père de la mariée, Antoine-François Delpierre (1764- 1854), fut député à l'Assemblée législative, député du Conseil des 500. Il ne vota pas la mort de Louis XVI, précise-t-on dans la famille. Son fils Émile fut conseiller à la cour de Metz. Il mourut en 1844 à Charleville, en présidant les assises. Son propre fils, Charles, né à Metz en 1820, épousa Françoise Octavie Moitessier, il fut le père du forestier Charles Guyot.
Monsieur et Madame Charles Guyot eurent cinq filles dont Jeanne, l'aînée, née en 1874, épousa René Nicklès, fondateur de l'école de Géologie de Nancy, tandis que Marie, née l'année suivante, épousa Georges Chrétien qui fut tué à Vitrimont le 26 août 1914. Le ménage Charles Guyot habitait Nancy et, à l'occasion des vacances de Pâques et d'été, venaient à Mirecourt et à Totainville, situé près de Rouvres-en- Xaintois sur la route de Vittel. Leurs enfants ont de merveilleux souvenirs de ces séjours où tout était différent de la vie à Nancy promenades dans la campagne et la bienveillante présence des ancêtres maman Laure, maman Octavie, la famille Delpierre à Valfroicourt, les Moitessier. les Buffet... À Pâques, il y avait la tradition des « treize desserts ». On imagine la joie des enfants
La maison de Totainville est voisine de l'église et du cimetière, dont une grande partie est occupée par les tombes des ancêtres Guyot et de leurs descendants. Durant les vacances d'été, quand il pleuvait. Madame Charles Guyot (maman Louise) quittait le village de Totainville pour la ville de Mirecourt. Charles Guyot se partageait, durant
les mois d'été, entre l'École forestière et sa famille. Il utilisait le chemin de fer et le service des Postes qui distribuait le courrier deux fois par jour. Aussi écrivait-il fréquemment à son épouse « Je ne t'écrirai pas demain, car j'arriverai presque en même temps que le courrier » (lettre du 4 octobre 1880). Dans ses lettres, il lui raconte ses journées, lui fait part de ses soucis concernant l'Ecole, des invitations à déjeuner ou à dîner en famille ou chez des amis. Il s'inquiète de savoir si les enfants toussent encore, si la pluie empêche les sorties, si son épouse ne s'ennuie pas. Il l'encourage à se distraire pour briser la monotonie des jours. « Organise-toi, lui dit-il, et surtout que je te retrouve bien contente et bien gaie à mon retour ». Tout l'été, ce ne sont qu'allées et venues entre l'École et la famille. « Pour comble de chance, écrit-il dans une lettre du 13 août 1880, et bien que les travaux des stagiaires commencent dès lundi, mon premier cours vient d'être remis à mercredi seulement, de sorte que je pourrai ne quitter Mirecourt que mardi soir. Si seulement il pouvait en être de même les autres semaines ».
Sa vie de famille fut exemplaire, comme le reflète cette lettre du 2 septembre 1880, écrite à son épouse à l'occasion de leur huitième anniversaire de mariage « Chère amie, Je me rappelle comme toi que ce jour est celui de notre mariage et cette date est toujours pour moi la bien venue, car depuis huit ans que nous sommes ensemble, tu m'as donné autant de bonheur qu'on peut en espérer ici. Souhaitons donc que ces huit années soient suivies de beaucoup d'autres semblables et tâchons de passer sur les petits ennuis qu'on rencontre sur le chemin. C'en est un par exemple de ne pas être aujourd'hui près de toi : je me réjouis doublement de revenir vendredi soir... Au revoir. chère amie, je t'embrasse comme je t'aime. Ton mari Ch. Guyot ».
Un grand forestier
Appelé à l'Ecole forestière en 1873 comme répétiteur du cours de Droit forestier. Charles Guyot y restera 36 ans ; devenu professeur titulaire en 1889, puis directeur en octobre 1898. il prit sa retraite en avril 1910. laissant à ses collègues et à ses élèves le souvenir d'un excellent professeur et d'un remarquable administrateur.
Il a écrit plus de dix livres importants et plus de deux cents articles édités dans diverses revues et bulletins : la Revue des Eaux et Forêts où il publiait chaque mois un article sur la jurisprudence forestière, le Bulletin du Comité des Forêts, le Bulletin de
la Société Forestière de Franche- Comté... En 1886, il publia ses Forêts lorraines avant 1789, travail «considérable et de toute première importance pour les historiens, les économistes et les linguistes » (E. des Robert). Son Enseignement forestier en France (1898) relate en 400 pages l'histoire de l'École de Nancy, ses difficultés, ses réformes, ses traditions. Excellent juriste, docteur en Droit en 1876, Ch. Guyot écrivit un Code de la législation forestière, en trois volumes, parus de 1908 à 1912, dont l'autorité exemplaire n'a jamais été contestée et qui a exercé une influence considérable sur des générations de forestiers. L'inspecteur général des Eaux et Forêts, M. Fortunet, dans son éloge du 27 décembre 1930, déclare que ce cours de droit forestier est de ces ouvrages si solides, si indiscutés, si parfaits, qu'ils ne laissent rien à découvrir après eux et qu'ils fixent la doctrine pour plusieurs générations. M. Guyot était devenu une des lumières de l'enseignement forestier. De toutes parts, dit-il, on le consultait dans les cas difficiles et lorsqu'il s'agissait d'éclaircir un point du droit forestier, ce qui venait aux lèvres de chacun c'était « Il faudra consulter M. Guyot ». Ch. Guyot poursuivait ainsi, en la développant admirablement, l'oeuvre entreprise par Alfred Puton, devenu directeur de l'Ecole, qu'il seconda toujours très efficacement avant de devenir son successeur. Son activité remarquable à l'École forestière lui valut d'être nommé commandeur du Mérite agricole dès 1903 et officier de la Légion d'honneur en 1908.
Pour ses tâches d'enseignant, il ne ménageait ni sa peine, ni son temps. Dans une lettre à son épouse, datée du 4 octobre 1880, il écrit: «Je ne pourrai pas revenir demain soir, mais
j'espère prendre le train de 10 h 30 mercredi matin. J'aurai seulement à passer à la bibliothèque qui ouvre à 9 heures : c'est pour un nouveau travail dont M. Puton m'a chargé ». Et ceci le 13 août 1892 : « Nous avons terminé ce soir à cinq heures le classement des élèves ; la plus grosse besogne est donc terminée. Néanmoins, je ne puis encore te dire d'une manière certaine quand je pourrai arriver : je doute que ce soit dimanche soir ; ce ne sera peut-être que lundi à midi. Tu penses bien que je ferai mon possible pour me hâter, mais cela dépendra surtout de M. Puton ».
Un animateur de sociétés savantes
Charles Guyot fut certes un forestier modèle, mais il fut aussi un historien érudit et un membre très actif de la Société d'Archéologie et de l'Académie de Stanislas. Ses travaux d'historiens ont paru dans diverses publications, dont celles de la Société d'Archéologie. Les seuls titres de ces derniers occupent plus de trois pages des tables de la Société. Ces nombreux articles traitent de sujets très divers, ils sont toujours appuyés sur des documents soigneusement dépouillés. Comme l'a écrit Ed. des Robert : « Ce qui caractérise tous ces travaux, c'est leur extrême précision et, si je puis dire, leur parfaite solidité ». Il s'intéressa aux trouvailles archéologiques si nombreuses en cette fin du XIXe siècle, « âge d'or » des recherches historiques, que commentaient avec compétence, au cours de réunions de la Société, « une phalange d'érudits remarquables » (Pierre Marot). Il fut un précurseur dans le domaine des recherches historiques de caractère socio-écono- pique ; son mémoire sur la situation des campagnes sous le règne de Mathieu II en est un bel exemple. Plusieurs notes montrent qu'il ne dédaignait ni l'archéologie, ni l'histoire de l'art, ni les traditions populaires. Il fut un très actif président de la Société d'Archéologie et du Musée historique lorrain de 1888 à 1898. À l'occasion du cinquantenaire de la Société, il brossa un tableau très
complet de ses origines et de son développement. Chaque année, il acceptait la tâche ingrate du rapport financier. Ses notices nécrologiques, qu'il tenait à rédiger avec précision, comme ses commentaires sur des publications adressées à la Société, sont toutes riches d'informations. Il reprit la publication des Documents sur l'histoire de Lorraine, interrompue depuis une vingtaine d'année, et tint à en préfacer de façon érudite le 16e volume publié en 1891. « Président modèle, il laissa notre Société en pleine prospérité lorsqu'il donna sa démission, qui coïncida avec sa nomination comme directeur de l'Ecole forestière » (Ed. Des Robert).
A l'Académie de Stanislas, il ne fut pas seulement « le plus dévoué des académiciens... mais aussi, de 1911 à 1930, le modèle des secrétaires perpétuels » (Charles Bruneau). Dans ces deux sociétés savantes, il savait animer les débats avec fermeté et avec la plus grande courtoisie. Comme à l'hôpital de la Croix rouge, dont il prit la responsabilité durant la guerre de 1914-1918 à Nancy, il fut dans ces sociétés un administrateur particulièrement efficace.
L'éloge funèbre très ému que fit le président Edmond Des Robert résume fort bien les qualités de Charles Guyot. « Sa vie a été une vie parfaitement unie, uniformément utile, d'une dignité extrême jointe à une extrême modestie. Ce sont des hommes comme Charles Guyot qui, dans le passé, ont fait la force de la Lorraine et la grandeur de la France. Ce serait d'ailleurs négliger un des traits les plus saillants de son caractère que de ne pas citer sa foi profonde et son patriotisme ardent ».
Geneviève Martin de Vivar
Reprise de l'article de Mme Geneviève Martin de Vivar du Pays Lorrain n°4 1996